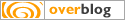Les grands romans sont des pièges. Non pour les lecteurs qui s’en délectent et se plongent dans ces univers sans images autres que celles des mots et des interprétations personnelles qui en découlent. Non. Le piège est pour les cinéastes, ou les scénaristes, ou les producteurs, ou tous à la fois, qui ne peuvent souvent résister à la tentation de porter à l’écran un livre qui les aura marqués autant que leurs concitoyens. Le piège c’est que chacun s’approprie un récit à sa lecture, et voir la retranscription de ce même récit d’un point de vue différent, en l’occurrence celui d’un cinéaste, à travers un film, s’avère bien (trop) souvent décevant.
Combien de fois, un grand film nait d’un grand roman ? Pas tant que ça. Ce qui n’empêchera pas le cinéma de continuer à porter à l’écran les ouvrages marquant de leur époque, et les spectateurs de faire les curieux pour voir ce qu’ « ils » ont tiré de leur livre adoré. Combien de fois me suis-je laissé piéger, de
Dune adapté de Frank Herbert par David Lynch à
La route adapté de Philip Roth par John Hillcoat ? (alors que pendant ce temps, Clint Eastwood est capable de tirer un chef d’œuvre cinématographique d’un roman de gare,
Sur la route de Madison… sacré Clint…)

Ces déboires confrontant le lecteur et le cinéphile qui sont en moi m’ont enseigné deux choses. Premièrement qu’un grand livre ne donne pas forcément un grand film, loin de là (et qu’un petit livre peut donner un grand film, hein Clint !). Deuxièmement qu’il ne faut pas voir un film juste après avoir lu le livre dont il est l’adaptation ciné (« pas tout de suite » signifiant pas dans l’année qui suit, si possible…). La précipitation ne donne jamais rien de bon (je repense à toi, satané Dune de David Lynch !!). C’est grâce à ce dernier précepte que j’ai attendu avant de voir Du silence et des ombres de Robert Mulligan.
Le film triplement Oscarisé de 1962, j’en avais entendu parler depuis des années sans jamais l’avoir vu. Cela faisait partie de ces classiques qu’il faudrait bien qu’un jour ou l’autre je vois. Mon ami Michael qui voue un culte féroce à Cameron Crowe (je sais, je sais… mais il a fait de bons films avant Vanilla Sky et Rencontres à Elizabethtown) m’en avait parlé le premier en me révélant qu’il s’agissait là d’un des films préférés de Crowe.
Un jour, il y a trois ou quatre ans, j’achetai un peu par hasard « Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur » de Harper Lee, justement le roman dont est adapté Du silence et des ombres. Lorsque je le lus, je découvris une œuvre incroyablement fine, un regard juste sur l’enfance, sur la ségrégation dans le sud des États-Unis. Un portrait drôle, touchant, attachant de l’Amérique profonde du début du 20ème siècle. Un grand roman. Un très grand roman (lisez-le vite si ce n’est déjà fait !!). Bien sûr, après l’avoir vu, l’envie de voir Du silence et des ombres m’assaillit vite. Mais les expériences passées (pfffff… ça y est, je repense à Dune, bon sang !) m’ont réfréné, et je me suis promis de patienter avant de regarder le film de Mulligan.
Les mois se sont écoulés, devenus années, et voici qu’inopinément, Du silence et des ombres est ressorti en salles le 7 juillet dernier en copie restaurée. Le temps s’était suffisamment écoulé pour que je me penche sur le film. Je me suis donc rendu dans la salle Langlois du Grand Action (qui aurait été parfaite avec de meilleurs sièges, il faut l’avouer), qui fut notamment le théâtre, il y a quelques années, de mon premier visionnage (en copie neuve à l’époque) de Rio Bravo de Howard Hawks. Aaaaaah, quel souvenir !
Ce qui me frappe dans Du silence et des ombres (oui, revenons à nos moutons…), c’est d’abord le titre. A l’époque le titre français ne s’était pas aligné sur le beau titre du roman, ce qui donne cet étrange « Du silence et des ombres », qui se rapporte autant au fond du film qu’à sa forme. Pour ceux qui auraient encore à découvrir le roman et le film, un éclaircissement scénaristique : Atticus Finch est avocat dans une petite ville d’Alabama au début du 20ème siècle. Il est également veuf, et doit s’occuper de ses deux garnements d’enfants, Scout et son grand frère Jem, qui n’aiment rien tant que traîner dans le quartier en espionnant le voisinage.
Atticus est un homme droit et juste, et lorsque le juge du comté lui annonce qu’il cherche un avocat pour défendre un homme noir accusé d’avoir violé et battu un jeune femme blanche, Atticus accepte. Plus que cela même, car Atticus va vite croire son client innocent et tout faire pour lui éviter la condamnation, tout en inculquant à ses enfants les valeurs qui sont les siennes.
Le roman d’Harper Lee, sorti en 1960, était un grand roman engagé contre la ségrégation raciale qui minait toujours amplement son pays à l’époque. Le tour de force du film de Robert Mulligan, c’est qu’il ne se contente pas d’être fidèle à l’écrit et de filmer ce qu’Harper Lee avait si bien décrit. Il donne vie au film avec un sens du décor et de la mise en scène palpables. La tendresse transparaît tout autant que l’inquiétude. Les décors sont aussi soigneux que la musique apporte un véritable souffle, tantôt joyeux, tantôt frissonnant.
Il parvient même à conserver, même si dans une moindre mesure, ce qui faisait la force et l’originalité du roman : raconter cette histoire du point de vue des enfants, et particulièrement de la jeune Scout. C’est la candeur d’un point de vue enfantin qui donne toute sa force à ce récit révoltant prônant l’égalité alors que celle-ci n’était pas franchement bien vue à l’époque. Il est impossible, également, de ne pas souligner l’interprétation remarquable de Gregory Peck, qui décrocha l’Oscar du Meilleur acteur pour ce rôle de père avocat. Face à lui, dans un rôle court mais déterminant, Robert Duvall, jeune et blond, faisait ses débuts d’acteur.
Du silence et des ombres a été tourné rapidement après la sortie de « Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur » (deux ans seulement). Je ne sais ce que j’en aurais pensé si j’avais manqué de recul. Aurais-je été séduit par ce noir et blanc jouant la carte de l’atmosphère au diapason de la musique d'Elmer Bernstein (c’est plutôt la musique qui est au diapason de l’image…) ? Je suis bien content d’être incapable de répondre à cette question, et de ne garder avec moi que la joie d’avoir enfin vu ce film qui me tournait autour depuis un certain temps. Et de n’avoir aucunement été déçu. Tiens, et si je redonnais une chance à Dune, moi ?