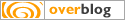Est-il possible qu’un distributeur sorte un film sans l’avoir
vu ? Quelle pensée diablesse que celle-ci ! Bon, certes, j’extrapole
énormément et en guise de distributeur, peut-être ne s’agit-il en fait que de
l’équipe marketing chargée de vendre le film. Ah oui, au fait, je parle de Sony
Pictures et « 21 Jump Street ». Oui, je soupçonne l’équipe marketing
s’étant occupée du film de n’avoir même pas vu le film dont elle avait la
charge. Si c’est vrai, cela en dit long sur la motivation au sein de Sony pour
s’occuper de leur catalogue. Cela paraît énorme et pourtant, le doute est à
peine permis.
 Vous me réclamerez la preuve de ce que j’avance, bien
sûr. La preuve tient dans un détail qui pourrait paraître anodin, mais si une
telle chose est anodine, alors effectivement, il ne faut plus s’étonner de
rien. Le problème tient dans la phrase d’accroche du long-métrage, placardée
sur toutes les affiches de France et de Navarre. En dessous du titre « 21
Jump Street », on peut lire ceci : « Être flic, c’était cool…
jusqu’à ce qu’on les envoie à la fac ! ». Mesdames et messieurs
travaillant au service marketing de Sony... Voyons. Un petit effort. Le film
dure moins de deux heures. Je suis sûr que plusieurs personnes travaillent dans
votre service. Je suis sûr que quelqu’un, au cours des mois qui ont précédé la
sortie du film, quelqu’un a bien eu le temps de jeter un œil au film. Allez,
même pas en entier, ne serait-ce que 30 ou 40 minutes. Non ? Vous n’aviez
pas un tel laps de temps disponible dans votre emploi du temps ces trois
derniers mois ?
Vous me réclamerez la preuve de ce que j’avance, bien
sûr. La preuve tient dans un détail qui pourrait paraître anodin, mais si une
telle chose est anodine, alors effectivement, il ne faut plus s’étonner de
rien. Le problème tient dans la phrase d’accroche du long-métrage, placardée
sur toutes les affiches de France et de Navarre. En dessous du titre « 21
Jump Street », on peut lire ceci : « Être flic, c’était cool…
jusqu’à ce qu’on les envoie à la fac ! ». Mesdames et messieurs
travaillant au service marketing de Sony... Voyons. Un petit effort. Le film
dure moins de deux heures. Je suis sûr que plusieurs personnes travaillent dans
votre service. Je suis sûr que quelqu’un, au cours des mois qui ont précédé la
sortie du film, quelqu’un a bien eu le temps de jeter un œil au film. Allez,
même pas en entier, ne serait-ce que 30 ou 40 minutes. Non ? Vous n’aviez
pas un tel laps de temps disponible dans votre emploi du temps ces trois
derniers mois ?
Bon alors attention, je vais vous faire une révélation
qui va vous faire un choc : les deux héros du film, incarnés à l’écran par
Jonah Hill et Channing Tatum… ils ne sont pas envoyés à la fac. Non non,
sérieusement. Ils sont envoyés au lycée. Arrêtez de rire, je vous assure, c’est
véridique. Je suis allé voir le film (moi). Je sais, je sais, comment peut-on
croire à Channing Tatum lycéen, c’est absurde, mais justement, c’est une des
qualités du film, cette capacité d’embrasser avec humour l’absurdité d’une
telle situation et jouer dessus. Allez, je vous le dis puisque l’on est à l’évidence
dans un moment où on se dit ce que l’on a sur le cœur. C’est doublement stupide
d’avoir ainsi bâclé votre travail, puisqu’en plus de perdre de la crédibilité
auprès des spectateurs potentiels, vous avez-vous-mêmes manqué ce qui sera
peut-être LA comédie US de l’année. Oui, « 21 Jump Street » est une
vraie réussite, une comédie hilarante, folle dans l’esprit et magnifiquement
maîtrisée dans la conception, alignant les situations et les répliques
irrésistibles dans un drôle de mélange de lourdeur et de finesse.
Malgré votre bourde, le film s’en tire plutôt bien au
box-office. Vous ne l’avez pas sorti dans énormément de cinémas, donc le nombre
d’entrées n’est pas impressionnant, mais le taux de remplissage des salles est
bon. Qui sait, peut-être qu’avec un peu plus d’effort et de confiance dans le
film, il aurait pu être un vrai succès, ce qui se fait rare pour la comédie
américaine en France. En tout cas, j’espère que pour ce qui est de vendre vos
films, vous assurez sur le reste de votre catalogue, parce que pour « 21
Jump Street », vous méritez un zéro pointé.
J’exagère peut-être, parce s’il y a bien un distributeur
qui mérite toujours plus de zéros dans son carnet de notes, c’est 20th Century
Fox. Encore eux. C’est drôle parce que l’article le plus lu de tout mon blog,
c’est celui dans lequel je poussais un coup de gueule envers la branche française du studio américain, pour cause
de VF intempestive lorsqu’ils sortaient une comédie confidentiellement. Il faut
croire que ce billet n’était pas remonté jusqu’à la Fox (ou qu’ils s’en foutent
royalement, après tout), puisque le distributeur a remis ça cette semaine, avec
une deuxième comédie dont la tête d’affiche est Jonah Hill. « Baby Sitter
malgré lui » de David Gordon Green,
« The Sitter » dans le texte. Une fois de plus, le film n’est visible
qu’en VF, sur Paris c’est au Publicis. La Fox n’a donc toujours pas compris
qu’aussi peu nombreux soient les spectateurs potentiels d’une telle sortie
technique, ils sont plus nombreux à attendre le film en VO qu’en VF, et qu’en
VF, le public potentiel ne se déplace pas. Je serais allé le voir, « Baby
Sitter malgré lui », s’il était passé en VO, et je connais d’autres
cinéphiles qui y seraient allés. Mais en VF, aucun n’ira (les chiffres ne
trompent d’ailleurs pas : 41 entrées en France pour son premier jour…).
Allô, il y a quelqu’un à la 20th Century Fox ?
Vous savez, que vous travailliez chez Sony ou 20th
Century Fox, je ne dis cela que pour votre bien et pour vous offrir la chance
de nous prouver que vous êtes capables de vous améliorer. Alors, tentés de
relever le défi ?