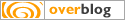Les années où le pays mis à l’honneur à Paris Cinéma ne me botte pas des masses, j’attache une attention toute particulière aux films de la compétition. Des films indépendants d’horizons variés, qui côtoient les avant-premières cannoises vers lesquels nous sommes tous un peu attirés. Chaque année est l’occasion de fureter et découvrir de beaux petits films (Aaaaaah, Old Joy de Kelly Reichardt, il y a quelques années…). Cette année, avec tous ces films japonais mis en avant qui me tendent les bras, je n’ai pas assez de temps pour me pencher avec autant de soin que je le voudrais sur les films en compétition.
Je n’ai le temps que pour deux d’entre eux, en fait, et ces deux films je les ai vus l’un après l’autre mercredi soir. Le croirez-vous, l’un est japonais, l’autre coréen ! Le premier s’intitule Sawako Decides et est réalisé par le jeune cinéaste Yuya Ishii (qui présentait également un deuxième film au festival, dans le cadre du focus sur le nouveau cinéma japonais, To walk beside you). Pour être rapide et caricatural, on pourrait appeler le film une comédie sociale féministe. La Sawako du titre a fui cinq ans plus tôt son patelin natal pour Tokyo, où elle n’a jamais su garder un mec, et n’a pas trouvé mieux qu’un job d’assistante où son patron la traite comme une moins que rien.
Alors lorsque son père, qui dirige une compagnie d’emballage de coquillage, se trouve au plus mal, et que son petit ami du moment, viré avec une gamine sur les bras, veut absolument qu’ils rentrent chez elle et qu’ils reprennent en main l’entreprise familiale, Sawako se laisse entraîner. Il faut dire que Sawako a un trait de caractère particulier. Elle est résignée. Elle pense que quoi qu’il arrive, dans le monde ou dans sa vie, elle n’y peut pas grand-chose. Alors elle laisse les choses se faire, sans tenter de prendre une quelconque emprise dessus.
Le titre du film s’avère très vite un énorme spoiler. On passe plus d’une heure en compagnie d’une jeune femme charmante mais tout fait incapable de prendre des décisions sur sa vie et préférant se laisser mener par les autres… alors forcément, il n’est pas difficile de savoir où Ishii va nous emmener. Mais ce n’est pas bien grave. L’essentiel, c’est que le long du chemin, le réalisateur nous présente des personnages cocasses empêtrés dans notre société. Cette société en crise à l’échelle globale, cette société où tout se répercute partout, et l’où on ne sait trop de quoi l’avenir sera fait. Tiens, c’est étonnant finalement à quel point le cadre et le fond ne sont pas si éloignés de Solanin, vu le week-end dernier. Certes le ton est radicalement différent, mais en fin de compte, on se reconnaît dans les deux tableaux. Preuve s’il en était de la lucidité de ces films. Même si au passage, je dois bien avouer que j’ai failli piquer du nez à plusieurs reprises devant Sawako Decides.
Pendant le film, je pensais sincèrement que la fatigue était plus fautive que l’œuvre en elle-même, mais juste après j’ai donc enchaîné avec La rivière Tumen, et là point de paupières lourdes me faisant lutter à chaque instant pour ne pas somnoler. Pourtant sur le papier, il semblait plus facile de se sentir fatigué devant le film coréen que devant le film japonais. A la comédie féministe a ainsi succédé un drame social prenant pour cadre un petit village chinois situé à la frontière de la Corée du Nord. Entre la Chine et la dictature de Kim Jong-Il, c’est un fleuve qui fait office de frontière naturelle. Un fleuve gelé en hiver, sur lequel traversent des nord-coréens cherchant à fuir le régime stalinien.
Dans ce village vit un grand-père avec ses deux petits-enfants. Elle est une jeune femme muette, lui est un garçon d’une douzaine d’années. Comme tout le monde dans ce petit village chinois, ils sont imprégnés de culture coréenne, jusqu'à parler la langue (sous une forme très locale tout de même). Et lorsque des nord-coréens demandent de l’aide après avoir franchi illégalement la frontière avec la police chinoise et l’armée coréenne aux trousses, ils leur ouvrent leur porte.
Vous conviendrez que le pitch de La rivière Tumen est moins entraînant sur le papier que Sawako decides. Si vous ajoutez à cela le retard du Festival, qui nous a fait poireauter debout un bon quart d’heure de plus devant la salle, les ingrédients auraient pu être réunis pour définitivement me plonger dans le sommeil après les phases intermittentes du film japonais précédent. Pourtant ce petit film coréen m’a tenu en haleine et en éveil pendant 1h30. Aucun étourdissement ou ronflement devant ce poignant drame humain.
Contée avec force sobriété, cette histoire de peuples déracinés, d’immigration clandestine, d’hommes, de femmes, et surtout d’enfants, amenés à être confrontés à la détresse humaine, souvent avec pudeur, ne commet aucune faute. D’un point de vue formel, c’est une maîtrise totale. Mise en scène élégante, décor subjuguant, difficile de ne pas être happé par le récit. Sur le fond, le réalisateur signe là semble-t-il une histoire très personnelle à laquelle il parvient à insuffler une vérité et une émotion brutes. Il tisse des personnages naviguant hors de tout manichéisme, confrontés à la difficulté de juger les hommes avec acuité.
C’est l’histoire d’une frontière derrière laquelle on ne sait trop ce qu’il s’y passe, tout en ne le devinant que trop bien. C’est l’histoire d’enfants trop jeunes pour comprendre toute la complexité d’un monde, tout en étant bien obligés de naviguer dans ses eaux troubles. C’est l’histoire d’un lieu extraordinaire et pourtant si banal. C’est l’histoire d’un film plein de courage qui laisse un goût amer. Un film qui devrait sortir dans les salles françaises à la fin de l’été, le 25 août. Notez-le bien.